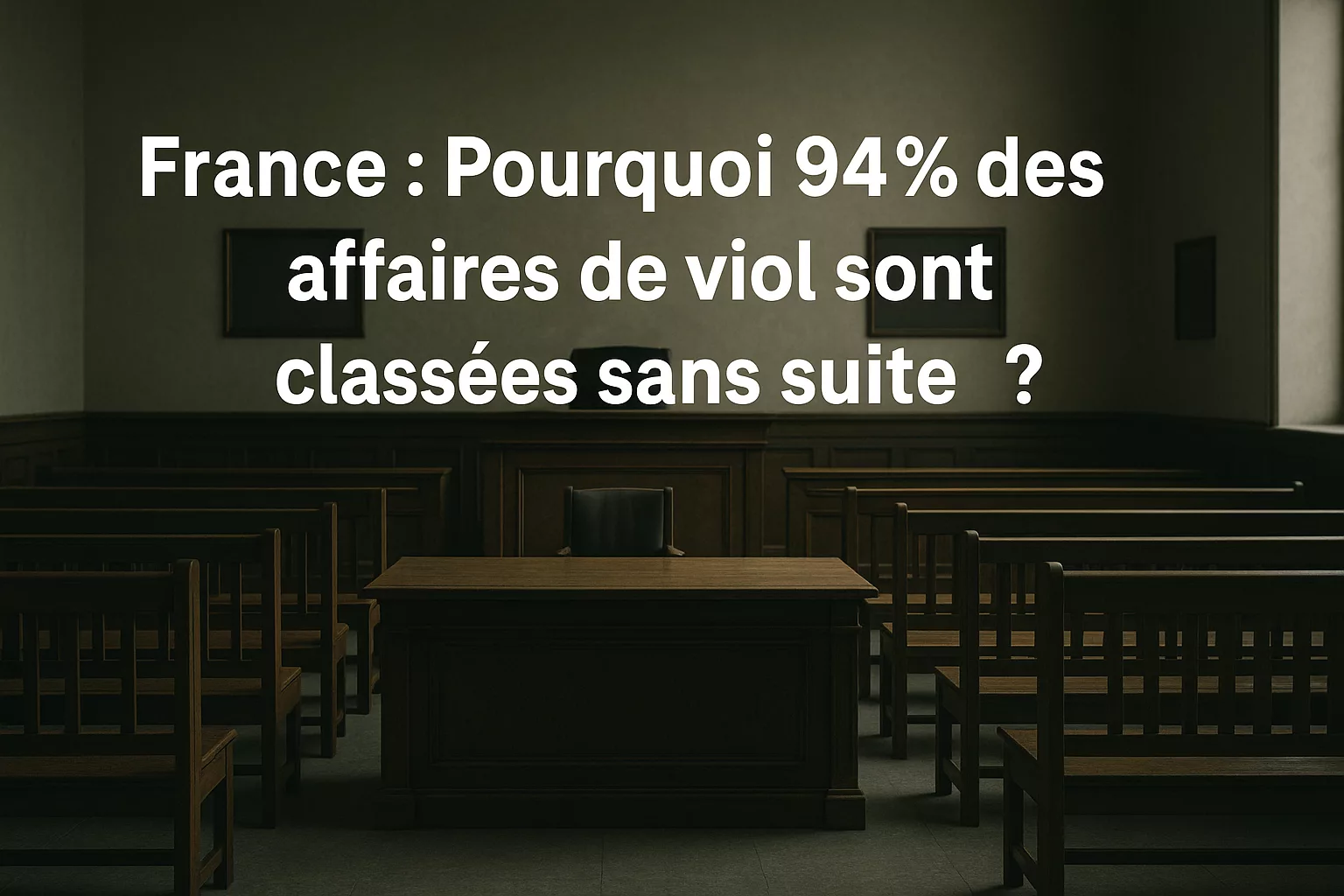France : Pourquoi 94% des affaires de viol sont classées sans suite ? L’impunité Française dénoncée par le Conseil de l’Europe !
Élise demande : « Comment peut-on parler d’État de droit quand 94% des viols en France ne débouchent même pas sur un procès ? Combien d’Élise, de Chloé, de Myriam devront encore être ignorées avant que la justice se réveille ? »
Elle s’appelle Élise. Ou plutôt, elle s’appelait Élise au moment où elle a cru que la justice était de son côté. C’était un soir d’hiver à Reims, elle avait 19 ans. Il y avait eu cette soirée, ces regards insistants, ce moment où tout a basculé dans une chambre à l’étage, sans cri, sans témoin. Puis le vide. Puis l’humiliation. Et enfin, le courage. Celui de franchir la porte du commissariat, de dire les mots, de tendre les preuves. Elle avait tout fait « comme il faut« . Un dépôt de plainte, un examen médical, une audition. Et trois mois plus tard, un courrier : « Affaire classée sans suite« . Aucun procès. Aucun face-à-face. Juste un dossier refermé dans un tiroir.
Ce que la jeune femme ignorait alors, c’est qu’elle venait de rejoindre une majorité écrasante. Elle n’était pas un cas isolé, mais une statistique vivante. Car en France, 83% des affaires de violences sexuelles sont classées sans suite. Et lorsque le crime porte le nom de « viol« , ce chiffre monte à 94%. Oui, neuf plaintes sur dix ne conduisent à aucune poursuite judiciaire. Aucun procès. Aucune condamnation. Rien.
Ce constat glaçant a été révélé le 16 septembre 2025 par un rapport du Conseil de l’Europe, via son organe d’experts, le GREVIO, chargé de veiller à l’application de la Convention d’Istanbul. Ce traité international, ratifié par la France en 2014, oblige les États signataires à lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Mais selon les auteurs du rapport, la France est largement en échec.
Ce rapport a fait l’effet d’une bombe. Car les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils révèlent que le pays des droits de l’homme est en réalité devenu le pays des silences. Celui des dossiers bâclés, des enquêtes incomplètes, des preuves négligées. Celui où l’on demande encore à une victime « comment elle était habillée« , « si elle a crié« , « pourquoi elle est restée« . Celui où les violeurs dorment paisiblement, pendant que les victimes restent éveillées.
Plus de la moitié des victimes recensées dans les plaintes pour viol ou agression sexuelle sont des mineures. Des adolescentes. Des enfants. Et pourtant, même dans ces cas, la majorité des affaires sont classées. L’horreur ne semble plus suffire à mobiliser. Il faudrait, paraît-il, des preuves irréfutables. Des images, des cris, du sang. Comme si la parole ne suffisait jamais. Comme si le viol devait être spectaculaire pour être jugé crédible.
Le rapport pointe une faille majeure : La définition même du viol dans le code pénal français. En 2025 encore, un viol n’est reconnu que s’il y a violence, menace, contrainte ou surprise. Ce qui veut dire que l’absence de consentement ne suffit pas. Une femme paralysée par la peur ? Pas de violence visible, donc pas de crime. Une jeune fille tétanisée, qui ne dit ni « non » ni « oui » ? Elle n’a pas lutté. Elle n’a pas crié. Elle n’est pas crédible. Elle est invisible.
Le Conseil de l’Europe exige que la France revoie sa copie. Il demande une réforme immédiate de la législation, pour adopter une définition du viol fondée sur l’absence de consentement libre et éclairé. Il réclame des formations spécifiques pour les policiers, les magistrats, les médecins légistes. Il alerte sur le manque criant de moyens. Trop d’affaires sont abandonnées faute de personnel, faute d’écoute, faute de volonté.
Les associations féministes, elles, ne sont pas surprises. Depuis des années, elles dénoncent cette impunité. Le mouvement #MeToo avait fait naître l’espoir d’un sursaut. Des paroles se sont libérées. Des visages se sont montrés. Des histoires sont sorties de l’ombre. Mais la machine judiciaire n’a pas suivi. Elle est restée sourde. Inerte. Rigidifiée dans ses archaïsmes.
Élise, elle, a tourné la page. Pas parce qu’elle a été apaisée. Mais parce qu’elle a compris. Elle a compris que la justice française ne se rendait pas toujours dans les tribunaux. Elle se rend dans les marches silencieuses. Dans les témoignages. Dans les mains qui se lèvent. Dans les mots qui dérangent. Elle a compris que pour survivre, il fallait parfois écrire sa propre vérité, seule.
Ce rapport du GREVIO n’est pas un rapport de plus. C’est un miroir. Un miroir tendu à un pays qui aime à se penser progressiste, protecteur, moderne. Mais qui, dans les faits, laisse des milliers de femmes chaque année se débattre seules contre l’oubli.
La France peut-elle encore ignorer ce signal ? Peut-elle se contenter de quelques promesses politiques et de quelques effets d’annonce ? Peut-elle continuer à dire aux victimes : « Nous vous croyons« , tout en classant leurs plaintes dans des boîtes poussiéreuses ?
Chaque plainte classée est une trahison. Chaque procès annulé est une condamnation de plus — non pas pour l’agresseur, mais pour la victime. Chaque silence est une insulte.
Élise n’aura jamais de procès. Mais peut-être, aujourd’hui, elle aura un peu de justice. Celle qui commence par la reconnaissance. Celle qui passe par un rapport. Par un chiffre. Par un choc.
83%. Il ne s’agit pas d’un taux. Il s’agit d’un échec. D’une honte. Et d’un appel à l’action.
👉 Article publié par MyJournal.fr, d’après les révélations du site Le Nouvel Obs.